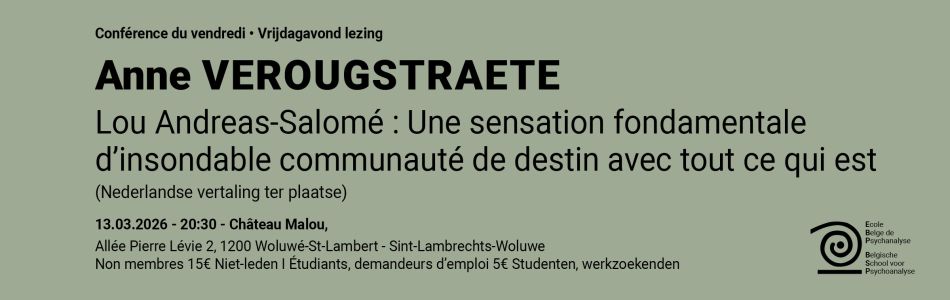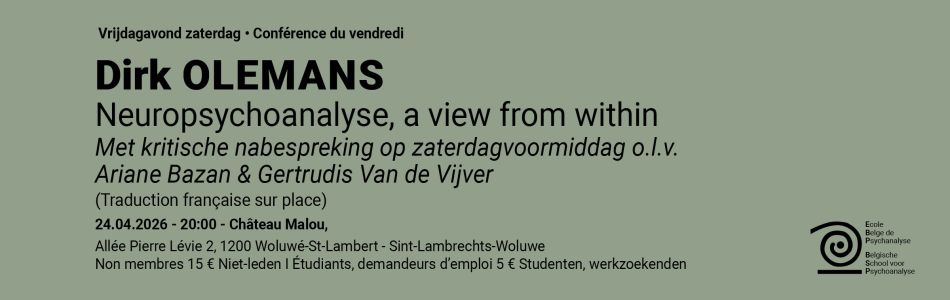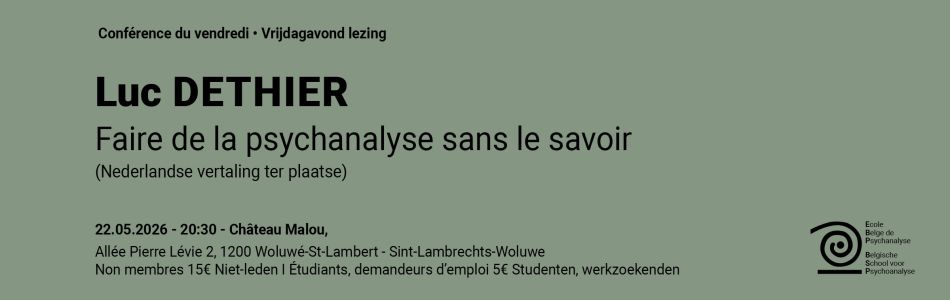L'Ecole Belge de psychanalyse
L’Ecole s’est créée à partir de la rencontre d’analystes francophones, néerlandophones et bilingues venus de plusieurs horizons de formation psychanalytique et universitaire (Hollande, Suisse, Allemagne, France) à la fin des années cinquante et au début des années soixante. L’espace de cette rencontre, en dehors de certaines amitiés déjà créées, a été le groupe analytique de la Société française de psychanalyse créé autour de Lacan, Lagache, Favez-Boutonnier, Dolto, marqué par une étonnante ouverture de la psychanalyse aux courants philosophiques, artistiques et littéraires de l’époque ainsi que des sciences humaines (anthropologie, ethnologie, linguistique, sémiologie, fortement inspiré du dialogue et des conflits entre phénoménologie et structuralisme). C’est dans ce creuset très actif que se forment les principes de base de l’Ecole belge de psychanalyse-Belgische school voor psychoanalyse...
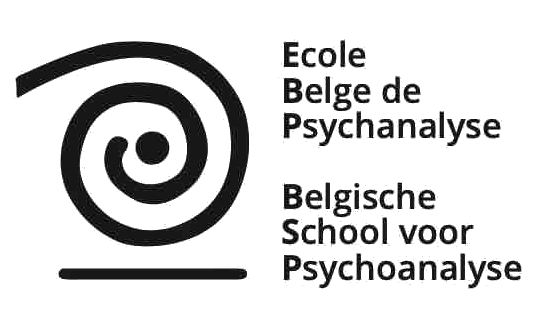
Publications de l'EBP/BSP
Dans notre menu "Publications" retrouvez nos textes fondamentaux et les liens entre la psychanalyse et le travail avec les enfants, la psychanalyse et la société, l'art, le psychodrame, les neurosciences, l'EMDR et nos "traces"...