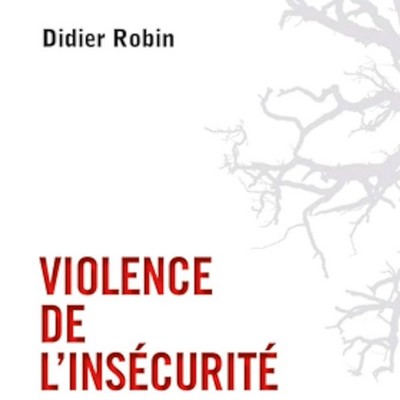 Il est tout à fait normal que quelqu’un qui pratique les « métiers de la relation », voire une équipe tout entière, connaisse des moments d’insécurité. Mais, il est alors très important de pouvoir qualifier cette insécurité sous peine de risquer de mettre en place des réponses qui vont, en fait, aggraver le problème. Je propose dès lors de nous appuyer sur une distinction mise en évidence par l’historien Jean Delumeau. Jean Delumeau, dans son livre intitulé Rassurer et protéger, le sentiment de sécurité dans l’Occident d’autrefois[1], nous amène à distinguer très clairement deux notions : d’un côté il y a la « sûreté », de l’autre la « sécurité » : « Dans son traité des Passions de l’âme, Descartes note : « […] Lorsque l’espérance est si forte qu’elle chasse entièrement la crainte, elle change de nature et se nomme sécurité ou assurance ; et […] lorsque la crainte est si extrême qu’elle ôte tout lieu à l’espérance, elle se convertit en désespoir. » Le Dictionnaire universel (1690) de Furetière définit—lui aussi—la sécurité comme un sentiment, un état d’âme et un comportement (individuel ou collectif). C’est « l’assurance dans le péril ; le manque de crainte. Un homme brave est intrépide au milieu des dangers, demeure tranquille, comme s’il étoit en pleine sécurité. On admire la sécurité de cet homme qui ne se sauve point, ayant beaucoup d’ennemis et de méchantes affaires. »
Il est tout à fait normal que quelqu’un qui pratique les « métiers de la relation », voire une équipe tout entière, connaisse des moments d’insécurité. Mais, il est alors très important de pouvoir qualifier cette insécurité sous peine de risquer de mettre en place des réponses qui vont, en fait, aggraver le problème. Je propose dès lors de nous appuyer sur une distinction mise en évidence par l’historien Jean Delumeau. Jean Delumeau, dans son livre intitulé Rassurer et protéger, le sentiment de sécurité dans l’Occident d’autrefois[1], nous amène à distinguer très clairement deux notions : d’un côté il y a la « sûreté », de l’autre la « sécurité » : « Dans son traité des Passions de l’âme, Descartes note : « […] Lorsque l’espérance est si forte qu’elle chasse entièrement la crainte, elle change de nature et se nomme sécurité ou assurance ; et […] lorsque la crainte est si extrême qu’elle ôte tout lieu à l’espérance, elle se convertit en désespoir. » Le Dictionnaire universel (1690) de Furetière définit—lui aussi—la sécurité comme un sentiment, un état d’âme et un comportement (individuel ou collectif). C’est « l’assurance dans le péril ; le manque de crainte. Un homme brave est intrépide au milieu des dangers, demeure tranquille, comme s’il étoit en pleine sécurité. On admire la sécurité de cet homme qui ne se sauve point, ayant beaucoup d’ennemis et de méchantes affaires. »
Il faudrait donc retenir que le mot « sécurité » exprime « la croyance bien ou mal fondée qu’on est à l’abri de tout péril », soit un sentiment, tandis que le mot « sûreté » renvoie à des réalités et à des situations concrètes : mesures de précaution, garanties diverses, confiance que l’on peut avoir en une personne, lieu où l’on est protégé des risques d’agression, protections assurées par des dispositifs techniques...
Pourquoi, en quelque sorte « revenir en arrière » alors que le mot « sécurité », encore peu employé avant le XVIIIe siècle, va petit à petit s’imposer et se généraliser pendant que l’usage de « sûreté » régresse ? Commençons à faire fonctionner notre distinction : si le vécu d’insécurité relève d’un problème de sûreté, il s’agit alors d’augmenter le degré de protection par des mesures concrètes. Par contre, si le vécu d’insécurité relève d’une série de sentiments il faudra non pas protéger mais bien plutôt rassurer.
Bien sûr, distinguer ne veut pas nécessairement dire opposer. Il est évident que sûreté et sécurité entretiennent des liens mais leurs recherches peuvent aussi aboutir à des résultats contradictoires. En effet, une augmentation de la sûreté est généralement obtenue par une mise à distance de l’autre associée à des formes de défiance : dispositifs de surveillance, fermeture des portes, pratiques d’isolement et de contentions physiques ou, plus subtilement, élaboration de procédures, etc. Par contre, la sécurité comme sentiment dépend de la qualité du Contact avec l’autre (concept très proche de celui d’« Attachement »), de la fonction Phorique (du grec « phoros » : qui porte). Il s’agit alors d’être suffisamment proche de l’autre avec une certaine bienveillance. Et, en écho, d’être suffisamment proche de l’autre en soi avec, là aussi, une certaine bienveillance. Que l’estime de soi d’un intervenant soit suffisamment bonne est indispensable pour permettre un degré de sécurité interne suffisant pour accepter de s’offrir à l’incertitude de la rencontre, que se soit avec un utilisateur ou avec un collègue.
Un premier exemple clinique peut permettre d’illustrer l’intérêt de la distinction entre sûreté et sécurité : « Quand les adolescents et les jeunes se livrent à des conduites à risques, ils mettent en danger leur sûreté et nous affolent. Nous avons alors tendance à considérer leur attitude comme parfaitement déraisonnable et nous essayons dans le même mouvement de les exhorter à la prudence. C’est que nous n’arrivons pas à voir que la prise de risque est une manière de prouver sa valeur, autant à soi-même qu’aux autres, et donc une manière de se rassurer. Autrement dit, la prise de risque menace par nature la sûreté, mais, par nature aussi, elle renforce la sécurité (comme sentiment). Du coup, notre distinction nous aide à aborder autrement les conduites à risque des adolescents et des jeunes parce que, si au nom de la sûreté nous essayons de les réprimer purement et simplement, nous contrarions la construction, si importante à cet âge, du sentiment de sécurité. Il devient alors clair que la meilleure manière de limiter les dommages consiste à encourager des prises de risques encadrées, c’est-à-dire des formes d’initiation aux dangers telles que les proposent certaines disciplines sportives ou artistiques (de la danse classique à l’acrobatie en passant par le breakdance… ), les mouvements de jeunesse, etc. Evidemment, nous ne donnons ici qu’une orientation générale qui ne résume pas cette problématique et ne prend pas en compte certaines spécificités de l’abord thérapeutique des conduites à risques pathologiques. Par ailleurs, on rencontre aussi beaucoup d’adolescents qui passent le plus clair de leur temps seuls dans leur chambre, entourés d’une télévision, d’un ordinateur, d’une console de jeu, d’un téléphone portable… Ils sont, dans ces moments-là, tout à fait en sûreté. Mais, doit-on s’étonner qu’ils témoignent malgré tout d’une profonde insécurité intérieure alors qu’ils sont comme coupés du monde et du contact réel avec les autres[2] ? »
Imaginons d’autres cas de figures, du côté des intervenants. Une équipe se sent insécurisée. Comme c’est malheureusement devenu un réflexe contemporain général, on va chercher à augmenter le degré de sûreté : de nouveaux dispositifs, de nouvelles procédures par exemple. On sait à quel point l’établissement de nouvelles procédures peut séduire les équipes et paraître rassurant. Devant l’incident inattendu plus de risque que la peur paralyse la pensée puisque l’on saura à l’avance quoi faire. Si A se produit, j’appliquerais donc la procédure B. Malheureusement, A ne se produit jamais tel quel, chaque « incident » est toujours unique. Aussi, quand A’ arrive B ne s’avère pas totalement adaptée et si je m’y cramponne, il y a beaucoup de risques que la situation dégénère.
Revenons au point de départ de cet exemple : une équipe se sent insécurisée. C’est une réalité normale et inconstestable. Imaginons qu’au lieu d’élaborer de nouvelles procédures, nous développions et cultivions des temps d’échanges des vécus de chacun, d’échanges à partir des difficultés rencontrées mais aussi des solutions trouvées à l’une ou l’autre occasion. L’effet alors très souvent produit correspond à l’articulation des fonctions Phorique (qui assure la sécurité de base), Sémaphorique (qui renvoie à d’authetiques partage de « signes », sema en grec, qui correspondent aux vécus du travail, autant dire autant des partages de points de vue, d’émotions voire même de sensations corporelles), Métaphorique (qui au dégagement d’un sens nouveau) et Euphorique (le plaisir du travail bien fait). La qualité de l’échange dans le respect et la co-présence, dans le Contact, apaise. Puis, chacun se nourrit de la pensée et des expériences de l’autre ; et découvre aussi en lui-même des ressources inattendues. C’est alors tout à fait un autre paradigme qui se déploie en terme de culture de travail : la procédure préétablie est remplacée par l’enrichissement d’une sécurité de base et d’une intelligence collective du travail qui permettra mieux de répondre à l’inattendu par l’invention sur la base de l’expérience.
A contrario, on sait que beaucoup d’établissements se focalise sur la transmission des informations, si possible en temps réel, et investissent des moyens considérables dans la mise en place de couteux systèmes informatiques. Ces systèmes ont certainement leur utilité mais, il y a malheureusement trop d’exemples d’établissements où le management a imposé une réduction parfois drastique du temps de réunion au non de la fluidité des flux de l’information. Or, sans suffisamment de temps de réunion, les informations (alors réduites au statut d’énoncés décontextualisés) circulent certes, mais le partage dans la co-présence physique des énonciations n’est presque plus possible. Les dynamiques transféro-contretransférentielles et les résonances ne sont alors plus repérables. La « Loi » de Stanton et Schwartz[3] se vérifie : l’impossibilté du partage en équipe (ou dans le réseau) des différences de points de vue et de positionnements subjectifs aboutit à une majoration des symptômes des utilisateurs (mais aussi, du coup, à une majoration de la souffrance éthique chez les intervenants avec toutes ses conséquences dommageables). Sans espaces de penser, intervenants et utilisateurs sont aspirés dans une spirale d’actions-réactions. Très concrètement, les intervenants sont plus souvent victimes de violence ou eux-mêmes plus maltraitants ; les utilisateurs se voient sur-médiqués, beaucoup plus souvent mis à l’isolement, contenus physiquement ou plus vite exclus des établissements résidentiels ou ambulatoires censés les acueillir.
En conclusion, il ne s’agit certes pas de balayer les mesures de sûreté les plus élémentaires ou les plus nécessaires. Mais, il faut prendre en compte que la sécurité dans le travail, comme sentiment, ne peut pas être un état stable. Les vécus d’insécurité sont tout à fait normaux ; ils sont même des signes à bien prendre en compte ! Seulement, dépasser ce type d’insécurité, sans doute le plus courant, ne se fait pas en renforçant les dispositifs de sûreté. Il faudra, au sein des logiques de la coopération, cultiver les logiques du Contact et le développement d’une intelligence collective.
Didier Robin, le 28 avril 2016.
[1] Delumeau., J, Rassurer et protéger. Le sentiment de sécurité dans l’Occident d’autrefois, Fayard, 1989.
[2] Robin., D, Violence de l’insécurité, PUF, 2010.
[3] Cf. Robin., D, Dépasser les souffrances institutionnelles, PUF, 2013.