Marc CROMMELINCK et Jean-Pierre LEBRUN - Un cerveau pensant: entre plasticité et stabilité
Psychanalyse et neurosciences (2017) - Résumé du livre par Phlippe CATTIEZ, suite à la soirée Contrepoint du 10 octobre 2023
1) Quel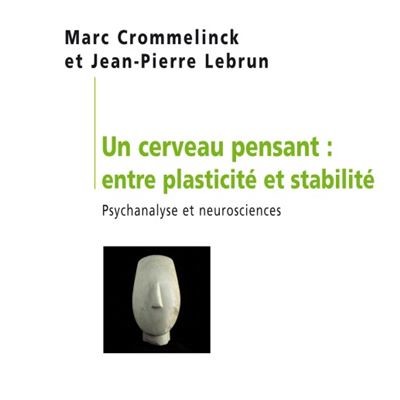 le épistémologie pour les neurosciences ?
le épistémologie pour les neurosciences ?
Le développement des neuroscience
Evolution du comportementalisme (1913) avec l’axe stimulus-réponse, passant par les sciences cognitives intégrant des intermédiaires complexes tels l’attention, le langage, les émotions, le mental, la conscience (1950), pour arriver à la psychophysiologie qui met en rapport un microniveau au niveau neuronal et un macroniveau de la psychologie cognitive (vers 1970) jusqu’à « l’homme neuronal » de Jean-Pierre Changeux (1980).
Fin d’un dualisme
Platon, dans Le Phédon, théorise le dualisme du corps et de l’âme.
Descartes défend rigoureusement le dualisme ontologique en distinguant deux substances différentes : la res extensa et la res cogitans.
La res cogitans est la pensée, une conscience réflexive, le Cogito : je pense, qui atteste de l’existence, donc je suis. La res cogitans est incorruptible et donc immortelle.
La res extensa est la matière, le corps, un corps-machine. Un modèle mécaniciste a rendu possible la physiologie, la biologie scientifique. C’était aussi l’époque de Copernic, Galilée, Newton, puis Lavoisier, Darwin : la biologie a abandonné les concepts métaphysiques, et donc la force transcendante de la matière.
Dualisme de Descartes entre sciences naturelles et humaines, entre corps et esprit.
Le coup de force de Descartes
La connaissance de la mécanique du corps a permis de se débarrasser de la pensée, de la psyché, et de ce fait a permis à ces dernières de leur donner un statut, et à l’individu de se penser comme sujet.
L’appui de Spinoza
La métaphysique de Spinoza ne se réfère qu’à une seule et même Substance infinie, qu’il nomme également Dieu, ou l’Etre. La création de l’Univers ne doit pas être attribué à Dieu, car Dieu n’est que Nature : « Deus sive Natura ». Mais cette Substance possède une infinité d’attributs. Les humains en connaissent deux : l’étendue (l’extensio), et la pensée (la cogitatio). Spinoza reprend ces deux termes cartésiens pour désigner des attributs, des propriétés d’une seule et même substance et non pour désigner les substances elles-mêmes. Spinoza évite toute forme de dualisme, entre Dieu et le monde, le sujet et l’objet, le mental et la chose, …
Spinoza ne place plus l’Etre au centre, « cogito, ergo sum » ; il affirme que l’être humain existe en tant qu’être pensant, « ego sum cogitans ». Dans l’éthique, le corps et l’esprit sont une seule et même chose, une seule substance, qui peut être tantôt l’étendue, tantôt la pensée. Il installe le monisme.
Le noyau dur de toute science
Les neurosciences dures fonctionnent avec un monisme matérialiste, avec une seule substance, la matière, et plus particulièrement le cerveau. Celui-ci possède de nombreuses propriétés : perception, volonté, action, mémoire, conscience, langage, …
Une seule substance avec plusieurs matières à travailler, et non pas les deux substances de Descartes. En réalité, dans le monisme de Spinoza, l’appareil psychique s’est constitué à partir de la machine du corps dans lequel il est inscrit.
Les enjeux du réductionnisme
Selon Changeux : « l’homme n’a plus rien à faire de l’esprit, il lui suffit d’être un homme neuronal ». La maladie mentale devrait être traitée comme le diabète, et que l’on puisse injecter un neurotransmetteur qui manque au maniaco-dépressif de la même façon qu’on injecte de l’insuline au diabétique. L’Evidence-Based-Medecine, réductionniste, contribue à la déshumanisation de la relation soignant-soigné, parce qu’elle ne prend pas compte de la spécificité du sujet parlant.
A l’inverse, pour Ludwig Wittgenstein, dans Tractacus logico-philosophicus, « A supposer même que toutes les questions scientifiques soient résolues, les problèmes de notre vie demeurent encore intacts … Il y a assurément de l’indicible ».
Le pastout (Lacan) rationnel, la possible singularité d’un sujet, n’est-elle pas précisément ce qui a spécifiquement émergé avec l’Homo sapiens ?
2) Le concept d’émergence
Le concept d’émergence est une pièce clé dans la tentative d’articuler monisme ontologique et pluralisme matérialiste qui soit une position non-réductioniste.
Selon John Stuart Mill, philosophe anglais du XIXèS, qui a pensé l’utilitarisme, l’émergence est associée à la non-additivité : « le tout est plus que la somme des parties ». La non-additivité peut être remplacé par l’idée de nouveauté. (le pastout).
Une propriété P d’un système naturel complexe S est dite émergente si elle est nouvelle, inédite, et cette nouveauté radicale implique une non-prédictibilité de P, un saut qualitatif, une rupture dans l’évolution ; au point de bifurcation, l’orientation de la nouvelle trajectoire ne peut être prédite.
Dans le cadre ces neurosciences, le macroniveau, celui des états mentaux, émerge du microniveau, celui des états neuronaux. Même si ce macroniveau est strictement déterminé par le microniveau, il est irréductible au microniveau. Un bon exemple est la dissociation entre sexualité et reproduction.
Dans le concept d’émergence, il y a une triple spécificité : la nouveauté (non-additivité), la non-prédictibilité, et l’irréductibilité. Le processus d’émergence a été inédit chez l’être humain (homo sapiens) par rapport aux espèces. Les propriétés mentales s’énoncent dans les discours des sciences humaines (psycho, philo, neurolinguistique, …).
L’émergence de l’humain
L’émergence de l’humain est identifiable dans sa spécificité de parole et de langage.
Spécificité du langage humain
Saussure, dans son Cours de linguistique générale (1915) distingue la parole, manifestation concrète du langage, de la langue, qui en est la forme systématique.
La langue est d’un ordre abstrait et la parole est d’une substance concrète.
La langue n’est jamais manifeste en tant que telle et relève d’une structure inconsciente. La langue sous-tend nos actes de langage et leur impose sa loi.
Dans la langue, pour Saussure, le signe résulte de l’association d’un signifiant (S) et d’un signifié (s). Le signe est arbitraire par rapport au signifié, avec lequel il n’a aucune attache naturelle dans la réalité.
Le signifiant est un fragment de la chaîne sonore, lui-même composé d’éléments sonores simples non-significatifs, à savoir des phonèmes. Le signifié associé au signifiant est une idée ou un concept. Les phonèmes se combinent pour former des morphèmes.
Lacan parle de l’être humain comme d’un parlêtre, par le fait de parler, de manier la langue, d’être manié par elle.
L’être humain est préprogrammé pour apprendre à parler, à maîtriser la langue qui précède toujours la venue de chaque individu. Cet apprentissage doit se faire au cours d’une période critique du développement , suivant un calendrier relativement déterminé, passant de la prosodie, ensuite la phonétique, la sémantique, enfin la syntaxe.
L’être humain est obligé d’en passer par l’autre, en passant par l’altérité, l’Autre, pour réaliser cette aptitude inscrite dans ses gènes.
Par ailleurs, il faut distinguer quatre principales modalités des énoncés : déclarative , interrogative, impérative et perfomative. Seul l’impératif existe chez l’animal, dans une logique de survie, vivre et se reproduire.
Conditions du langage
L’être humain s’entre-tient,en ne se touchant pas, mais par la parole. La néoténie le contraint de devoir se brancher sur les autres et de prendre appui sur les connexions cérébrales pour intégrer notre manière de faire lien.
Un monisme motérialiste
La lalangue de Lacan est cette langue première , jargon entre la mère et l’enfant.
Le motérialisme, matérialité des mots, dit bien l’importance des mots, de leur équivoque.
La question de l’exception
La place de l’exception appartient au chef, au roi, au pape, à Dieu. Mais aussi dans le règne animal, place de l’exception à l’homo sapiens, le seul qui possède le langage.
La res cogitans est exception par rapport à la res extensa.
Mais dans les sociétés occidentales, démocratiques et scientifiques, on assiste à la promotion de l’horizontalité qui se substitue à la verticalité. On assiste à une remise en question de la loi des trois A : Autorité devenue illégitime, Altérité au profit du même, Antériorité balayé par le présentisme (JPL).
Du Totem et Tabou de Freud, comme exception consistante, Lacan postule l’au-moins-un, dans une place logique et irréductible, qui n’a plus à être vraie, mais à être tout court.
Condition de possibilité
L’être humain, s’il veut assumer son destin de parlêtre, est l’obligé du langage. Il doit se soumettre au Réel du Symbolique.
Comme les animaux, l’homme vit dans une biosphère. Mais chez l’homo sapiens se creuse une sémiosphère, ensemble de signes porteurs de sens et qui s’enrichissent jusque dans l’abstrait (les mathématiques), créée par lui, et dont il est en retour le produit.
Transmission et incarnation
La question qui se pose est une occupation, une incarnation de la place d’exception qui n’est pas simplement virtuelle, simple instance logique : il faut des parents, des professeurs, des élus, en chair et en os.
Mais il faut que cette place soit reconnue comme place logique valant en soi, reconnue comme telle, et qui n’est plus identifiée au fait que quelqu’un l’occupe.
3) Les causalités, ascendante et descendante
Distinction entre cause mécanique et cause intentionnelle (la raison).
La causalité ascendante
Le microniveau se réfère au monde (aux concepts) de l’anatomie et de la physiologie du système nerveux. Le macroniveau se réfère au monde (aux concepts) de la psychologie cognitive et plus largement des sciences humaines. Il s’agit ici de nos états mentaux : désirs, croyances, intentions, … , et les comportements en interaction avec l’environnement tant physique que social et culturel. Les propriétés du microniveau déterminent celles du macroniveau.
Au niveau clinique, les homoncules (Penfield) au niveau des cortex moteurs et sensoriels sont le point de départ des cartes corticales. Les lésions ou stimulations ont un effet direct sur la pensée. Dans le cas de l’autisme, des éléments de ce microniveau peuvent rendre difficile l’audition, la perception, la parole, et empêchent la constitution du lien précoce mère-nourrisson, indispensable pour la construction psychique de l’enfant.
L’efficacité très précoce des causalités ascendantes sont déterminantes dans la mise en place ces structures cérébrales. Ainsi les prédispositions innées du nourrisson à porter son attention vers le visage de la mère, à produire et reconnaître des phonèmes, la reconnaissance précoce de la voix de la mère, la perception visuelle, … Dans l’embryogenèse du cerveau humain, on assiste à la mise en place de structures anatomiques et physiologiques caractéristiques de notre espèce homo sapiens, ceci au niveau des connexions, de la synaptogenèse.
Le langage est un propriété définitoire de notre espèce, et nous sommes préprogrammés pour parler. Au cours de l’embryogenèse, l’’hémisphère gauche est plus développé que le droit, asymétrie innée. Jusqu’à l’âge de 3 ou 4 ans, en cas d’accident, la plasticité cérébrale est suffisante pour que l’hémisphère droit non dominant puisse prendre en charge la fonction langagière.
Autre causalité ascendante : la catégorisation perceptive des couleurs est présente bien avant que l’enfant ne maîtrise les codes lexicaux de dénomination des couleurs.
Et surtout : l’émergence de la culture. On peut invoquer une causalité ascendante entre les propriétés du microniveau et l‘émergence de la culture qui est une des marques essentielles du macroniveau chez l’humain. Le langage et la culture sont au cœur de l’Umwelt humain, elles sont définitoires de la forme de vie propre à l’humain.
Au niveau du macroniveau, il n’y a pas que des états mentaux et comportementaux individuels, il y a aussi toute la dimension de l’histoire et de la culture. La culture a laissé, tout au long de l’histoire, des traces matérielles dans l’environnement, la culture, des inscriptions matérielles de plus en plus riches et pérennes des pensées, des émotions, des mémoires, des représentations mentales : la sémiosphère.
L’homo sapiens met en oeuvre une fonction déclarative et une fonction interrogative.
Par la fonction déclarative, l’humain tisse le monde au sein d’un réseau dense et ordonné de propositions, de catégorisations : des noms, des prédicats, des concepts, …
A la faveur de la fonction interrogative, l’humain troue cette trame de mille et une questions. A chaque fois qu’il ouvre le questionnement, quelque chose d’un vide surgit, un blanc infini à cette recherche de sens.
Cette dynamique culturelle – langage, croyances, savoirs, art, déclaration-interrogation – constitue un ensemble de propriétés émergentes des cerveaux humains. Ce degré de complexité ne se retrouve pas chez les grands singes : les 2% de différence du matériel génétique font toute la différence.
Un causalité descendante
La causalité descendante se réfère à certaines propriétés, mentales, langagières et culturelles ; ces propriétés émergentes du macroniveau sont en mesure d’agir rétroactivement sur les propriétés du microniveau, la structure et le fonctionnement cérébral. Le langage et la culture seraient susceptibles de sculpter progressivement le cerveau qui leur a donné naissance, ceci d’autant plus que cette causalité s’appuie sur la néoténie. La culture donne forme à l’esprit … et au cerveau qui le sous-tend.
La plasticité cérébrale
La plasticité se réfère aux propriétés de modifiabilité à court et à long terme des réseaux nerveux sous l’action des facteurs de l’environnement. Eric Kandel (Nobel de médecine en 2000) a montré la malléabilité de mécanismes cellulaires et moléculaires, et l’inscription de traces durables dans la matérialité des réseaux nerveux. La plasticité est particulièrement importante chez l’enfant, au cours de certaines périodes critiques du développement. Mais chez l’adulte, on peut également observer la capacité à remanier sa propre structure nerveuse en interaction avec l’environnement.
L’interaction des causalités avec les périodes critiques
Les deux lignes de causalités sont interdépendantes dès la naissance avec des pics de sensibilité au cours de périodes critiques : il existe des fenêtres temporelles pour acquérir telle ou telle aptitude.
Lacan remet en question la prévalence qu’il donnait au signifiant, autonome de la matérialité ; au contraire, avec sa notion de motérialisme, l’esprit reste tributaire de la réalité concrète, qu’en retour, par le biais de la causalité descendante, il réaménage.
La prosodie de la mère constitue la clé d’entrée dans la langue, mais avec ensuite des étapes d’élagage. De même, la reconnaissance du visage de la mère s’étaye sur l’appréhension d’une forme visuelle simple : un ovale avec des points de contraste pour les yeux et la bouche.
Vu la néoténie, l’homme naît trop tôt. Le nourrisson naît donc avec un cerveau trop petit. Son cerveau n’est que de 300 g pour atteindre 1,4 kg à l’âge adulte. L’augmentation du poids résultera de la densité du réseau synaptique et de la myélinisation.
Il y a des périodes critiques pour le développement du système visuel : la vision en profondeur se confirme au moment où l’enfant pourra coder la disparité de l’image sur les deux rétines.
Il existe des mécanismes de plasticité cérébrale plus efficaces à un moment donné du développement, notamment pour l’apprentissage de la lecture.
Le nourrisson se branche presque naturellement à l’autre. Il montre sa capacité d’imitation quelques heures après sa naissance : il imite de façon presque réflexe les expressions faciales de l’adulte. Cette imitation réflexe diminue vers trois mois au profit de l’intérêt pour le sourire de l’adulte, même s’il sourit déjà avant pendant le sommeil paradoxal, ce qui indique qu’il y a une sorte de modèle interne disponible. Un autre exemple est la contagion émotionnelle des pleurs.
Dès sa naissance, l’enfant se branche sur le voix et le visage de sa mère.
Dans le milieu intra-utérin, l’enfant n’entend que les basses fréquences de la voix de sa mère. Dès la naissance, il entend des fréquences plus hautes qui permettent de différencier les phonèmes, et donc de devenir sensible aux mots, aux signifiants.
Plus tard, le pointage du doigt précède l’action de mise en mots, – de façon proto-impérative, je veux cela, la demande, – ou de façon déclarative, j’ai vu cela. Il sait que ce n’est pas son doigt qu’il faut regarder, mais l’objet qui est au-delà de lui.
Dès qu’il peut se déplacer, il fait l’expérience du changement de point de vue. Cette démarche n’est plus egocentrée mais devient allocentrée. L’autre me voit autrement.
4) Le rapport du corps au langage
Il s’agit de distinguer le glissement récent où a été réduit le modèle hétéronome – religion, patriarcat, modèle pyramidal, registre symbolique -, vers le modèle autonome – (neuro)sciences -, qui arrive et devient structurel. A présent, dans le monde de l’autonomie structurelle, l’individu est posé comme premier, et le social en second ; cela à l’inverse de ce qui était à l’oeuvre dans le monde hétéronome. Et ce n’est pas sans susciter une méconnaissance, car il reste évident que, pour qui s’intéresse à la réalité psychique, l’altérité est première. Aujourd’hui, l’hétéronome est effacé pour de bon, et l’illusion de l’autonomie voudrait être alors partagée collectivement ([1]).
L’introduction du langage
Le planum temporale de l’hémisphère gauche, qui correspond à l’aire de Wernicke pour la compréhension langagière, et l’aire de Broca pour la production langagière existent avant la naissance. In utero, l’enfant entend les voix et particulièrement celle de sa mère, en basse fréquence (200 à 400 Hz) qui sont des composantes prosodiques . A la naissance, l’enfant reconnaît la voix de sa mère. A la naissance, le nourrisson naît avec des détecteurs centraux préprogrammés sensibles à la forme du visage. De 3 à 7- 8 mois, l’enfant peut produire des phonèmes, tout comme l’enfant sourd ; on déduit qu’il s’agit également d’un préprogrammation (ndlr : pour la prosodie). A partir de 10 ou 12 moins, par élagage progressif, l’enfant ne retiendra plus que les phonèmes rencontrés dans la langue maternelle. La prosodie reste pour l’émotionnel, mais ensuite l’enfant passe au différentiel pour reconnaître les différents phonèmes. L’enfant est pris dans une dyade communicante mère-enfant.
L’attachement
René Spitz, James Bowlby.
Cependant, l’enfant est d’emblée pris dans le symbolique. Si on met trop l’accent sur l’attachement, on risque de faire exister de manière trop consistante un en-deça du Symbolique. La mère doit transformer le besoin en pulsion.
Il y a une différence avec les primates, il y existe une rupture également par l’écriture.
L’émergence de l’écriture
Par l’écriture, les sons évanescents de la langue sont inscrit sur un support. On associe les graphèmes – des dessins -, avec des phonèmes – des sons. Il faut des dizaines de milliers d’années (des millions) pour que des phénotypes se transforment en inné, qui joue en causalité ascendante. Or l’écriture généralisée n’existe que depuis quelques centaines d’années. D’où le rôle de la causalité descendante et de la plasticité.
Il existe autour de l’âge de 5 ans une fenêtre de plasticité permettant de lire en quelques mois ([2]). Chez l’adulte, cette plasticité sera refermée. Il existe un recyclage d’une carte cérébrale. Un module cortical de voies visuelles va évoluer vers une nouvelle fonction, celle de la lecture. L’aire 37 du gyrus fusiforme gauche, programmée pour le traitement des formes du visage se recycle pour traiter les formes des lettres. Cependant, les formes du visage est une forme naturelle alors que la forme de la lettre implique la culture, pour reconnaître les lettres. Deux grands réseaux corticaux doivent avoir atteint leur maturité. : le réseau phonologique, vers 10 – 12 mois, qui permet la reconnaissance et la production des phonèmes, et la réseau sémantique ou lexical, qui concerne les unités de sens, vers 3 – 4 ans. A cet âge, le lexique, bien incomplet, sera suffisant pour l’enfant de se faire comprendre. Et c’est le moment favorable pour que ces deux réseaux deviennent comme un attracteur pour attirer ce module 37, destiné initialement à la reconnaissance des visages ([3]). En revanche, celle-ci se poursuit dans l’hémisphère droit.
C’est le langage qui impose le processus de recyclage cérébral, causalité descendante.
L’apprentissage de la lecture
Par la méthode globale, l’enfant devine les formes visuelles globales sans véritablement lire. En opposition, il faut prôner l’apprentissage de la reconnaissance des différences : ba-be-bi-bo-bu ([4]).
L’aire 37 est destinée à la reconnaissance des visages, avec un principe d’organisation symétrique. A l’inverse, l’écriture implique une asymétrie. En français, l’apprentissage de la lecture avec le doigt, commence de gauche à droite, il y a à la fois une asymétrie de l’attention – motrice -, et de la motricité oculaire. L’asymétrie n’est pas naturelle. Mais parfois la nature fait obstacle à la culture (dyslexie, …)
Avec la méthode globale, les enfants devinent plus qu’ils ne lisent.
Dans l’après 68, sous couvert d’égalité, la méthode globale, est un refus de verticalité ; l’image – symétrique- est naturelle, et la lettre – asymétrique – est culturelle.
L’apprentissage du calcul implique le même recyclage des cartes corticales. A un moment donné, les quatre opérations de base, addition, soustraction, multiplication et division, doivent être apprises en même temps. Il ne faut pas reporter la division, plus difficile, à plus tard, au risque alors d’induire des dysfonctionnements.
5) L’avènement du numérique
Les principales fonctions neurocognitives – attention, émotion, mémoire, écriture et lecture – vont-elles évoluer, via la causalité descendante, avec l’avènement numérique ?
L’impact sur le psychisme
La digitalisation transforme une information quelconque – test écrit, discours, image fixe ou vidéo, une musique – en une suite de 0 et 1. Le transcodage n’est plus accessible à nos sens. Dans un deuxième temps, le nouveau message codé sous forme digitale peut être stocké sur un support physique. Et il faut encore un troisième processus machinique pour retransformer le code numérique en un contenu user friendly afin qu’il soit accessible à nos sens. Il faudra trois processus pour passer de la culture au sens traditionnel à la culture au sens numérique ou virtuel.
La disponibilité de l’information, son accessibilité et sa variabilité constituent trois caractéristiques transformées par la numérisation.
Du point de vue de la disponibilité, les quantités d’informations disponibles sur la toile sont équivalents à des centaines de millions de BNF laquelle contient quatorze millions de volumes. Le problème réside dans la quantité, voire la surcharge. Un autre problème réside aussi dans la gestion de ce stock culturel, laissée aux entreprises commerciales, mais suivant quelle logique ? On assiste à une entropie, à un désordre de l’information.
Ensuite l’accessibilité est devenue exceptionnelle et plus en plus rapide : de la 2G à la 5G. La technique devient un besoin, le smartphone devient un compagnon de vie.
Enfin la variabilité : tout type d’information peut être codé, transmis, stocké, partagé en temps réel.
Les relations de causalité descendante permettent aux neurosciences d’éclairer de manière nouvelle l’éducation et la pédagogie. La question se pose de savoir si le numérique, en tant qu’innovation et en tant qu’émergent culturel, modifiera le cerveau. La réponse est clairement affirmative.
La mutation numérique en est-elle vraiment une ?
Il existe trois ensembles de savoirs et techniques qui permettent à l’homme d’amplifier sa maîtrise sur la nature et sa propre histoire.
Le domaine moteur : l’invention d’outils pour développer des forces, des leviers jusqu’au nucléaire. Le domaine sensoriel et le développement du microscope jusqu’au télescope. Enfin le domaine cognitif, de la machine à calculer de Pascal jusqu’à nos ordinateurs. Par ce dernier domaine, il s’agit d’externaliser nos contenus mentaux, non seulement par la parole ou le comportement, mais en les inscrivant par des techniques adéquates sur des supports matériels, permettant de les conserver de manière pérenne, et de les transmettre de générations en générations, avec une nette amélioration par rapport aux seules capacités naturelles.
Effets bénéfiques, effets délétères
Chez des jeunes pratiquant de manière intensive des jeux vidéo, on peut citer plusieurs modifications : 1) l’acuité visuelle est significativement améliorée, tout comme la sensibilité aux contrastes. 2) on assiste à une amélioration des performances de l’attention sélective. 3 ) les fonctions frontales et préfrontales se développent par le repérage de l’efficacité de différentes solutions. 4) les coordinations visuo-manuelles sont sollicitées de manière spectaculaire, avec amélioration du temps de réaction et de précision du geste. 5) amélioration de la mémoire de travail. Néanmoins, il convient de noter des effets néfastes : 1 ) l’addiction au jeu. 2) corrélation négative entre les heures passées au jeu et rendement à l’école. 3) augmentation des réactions agressives. 4) diminution de l’empathie et désengagement de la relation à l’autre. 5) augmentation du stress. 6) flou entre réel et virtuel, moi virtuel lancé dans le jeu comme avatar. Les satisfactions immédiates sont privilégiées au détriment des bits à plus long terme.
Le numérique stimule le circuit court de recherche de l’expérience du plaisir connues comme les structures limbiques dopaminergiques, avec ce qui privilégie l’instant présent au détriment de planification à plus long terme.
La mémoire risque de devenir moins performante et plus superficielle. Il est vrai que le stock d’informations disponibles est désormais accessible sur le smartphone. Mais la mémoire assure une base indispensable à la structuration de la pensée.
Lorsque l’on partage des ressources attentionnelles sur plusieurs sources, le traitement multitâche est moins performant. La dispersion est préjudiciable pour le bon fonctionnement du cerveau. Le sujet est addicté par ces objets connectés, parfois qualifiés d’armes de dispersion massive.
On constate un appauvrissement de la pensée linéaire, comme lire une page au complet, en faire la synthèse, analyser et résumer un texte. Cela au profit d’un schéma de pensée en réseau, arborescent, qui ne découvre que dans l’après-coup une structure logique.
L’écriture au clavier peut pâtir de l’absence de la motricité fine par la main qui, dans l’écriture traditionnelle, trace la forme des lettres.
Conclusion
Le trait spécifique de l’humain n’est pas tant la fiction paternelle – le père, le patriarcat, depuis le monde gréco-romain –, en déclin, mais essentiellement le langage.
La plasticité change la forme des corps solides et ensuite la déformation se maintient.
La plasticité constitue le mécanisme effecteur de la causalité descendante, à savoir l’inscription des traces du monde qui nous entoure, de la culture et du langage, dans les structure du cerveau.
(Résumé par Phlippe CATTIEZ)
[1] (NDLR : Contrairement à des neurosciences dualistes et réductrices, et prônant l’autonomie et l’individualisme, à l’inverse, des neurosciences « éclairées » comprenant des causalités ascendantes et descendantes devraient rétablir la verticalité avec hétéronomie et transcendance).
[2] S. Dehaene, les neurones de la lecture, Paris; Odile Jacob, 2007
[3] S. Dehaene et L. Cohen, “Cultural recycling of cortical maps”, Neuron, n°56, 2007, pp.84-98.
[4] (NDLR: passage d’images visuelles vers la reconnaissance de graphèmes -> phonèmes -> chaîne S.)