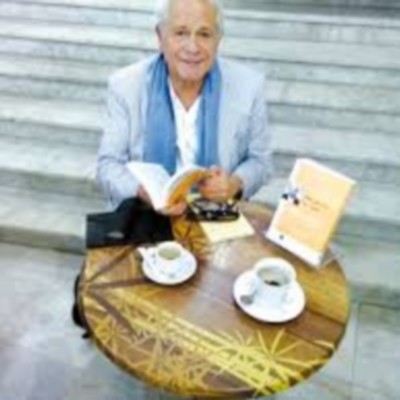 En instituant cette dimension des Traces, Lina Balestriere, (soit dit en passant, notre première Présidente de l’EBP-BSP !) a inauguré en quelque sorte, un nouveau moyen de communication entre les membres de l’école. L’espace prévu donne l’occasion de choisir ce mode somme toute, assez humble, pour dire l’expérience d’une rencontre analytique et établir ainsi une trame permettant de tresser de multiples fils, de multiples liens, tant interpersonnels que intrapsychiques. Initiative ingénieuse qui permet de garder une question ouverte et la faire circuler entre nous, ou des questions ouvertes de façon à créer un mouvement de travail.
En instituant cette dimension des Traces, Lina Balestriere, (soit dit en passant, notre première Présidente de l’EBP-BSP !) a inauguré en quelque sorte, un nouveau moyen de communication entre les membres de l’école. L’espace prévu donne l’occasion de choisir ce mode somme toute, assez humble, pour dire l’expérience d’une rencontre analytique et établir ainsi une trame permettant de tresser de multiples fils, de multiples liens, tant interpersonnels que intrapsychiques. Initiative ingénieuse qui permet de garder une question ouverte et la faire circuler entre nous, ou des questions ouvertes de façon à créer un mouvement de travail.
A cette occasion, j’ai repensé à la rencontre avec Heitor de Macedo qui a eu lieu en octobre 2009. Comment arriver à rendre sensible à d’autres, après tous ces mois passés, la profonde impression que cette rencontre avait produite chez moi ? En effet, tant les propos que leur énonciation et les positions d’analyste de Macedo m’ont parus susceptibles d’opérer une fonction de transmission et une féconde mise au travail.
C’est en lisant le texte de Paul Hentgen sur l’atelier animé par M. Garcia lors des journées cliniques à Hélécine, qu’une piste s’est ouverte. Cette piste, c’est, la question du style, mais aussi celle des liens, ce dont parle Freud dans “Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient” à savoir, la capacité “de rattacher sa vie à celle d’autres personnes…”
Dans ce texte, j’ai perçu quelque chose qui entrait tout à fait en résonnance avec le souvenir de la conférence donnée par Heitor de Macedo le vendredi soir, mais aussi avec les échanges de la matinée du samedi en petit groupe.
Pour introduire son cas clinique le vendredi H.M. a posé quelques préliminaires à la présentation de cas. Il nous dit la nécessité d’une méthode de présentation qui soit homogène à la psychanalyse, une méthode qui évite de “parler sur” ou de, mais de chercher à dire, ce qui constitue l’expérience d’une cure, ce qui constitue la psychanalyse.
Décider que la forme soit homogène à la psychanalyse n’est pas sans introduire une certaine tension, pour ne pas dire une tension certaine, avec une dimension plus académique, classique, souvent très extérieure, “spectaculaire”, et une présentation plus intérieure, celle plus modeste, quotidienne et intime, celle de dire le rapport établi entre un analyste et son analysant, rapport transférentiel de deux inconscients, engagement de deux sujets, dont l’un peut devenir “le contenant de l’autre”. De là découle la nécessaire implication de celui qui parle de sa clinique, implication éprouvante pour le narcissisme. C’est cette implication qui m’a laissé cette profonde impression.
Rester dans un registre qui n’aboutit pas…à une doctrine, à de la théorie, c’est renoncer à faire partie des doctes, c’est renoncer à la brillance de l’érudition psychanalytique qui encombre parfois les réunions de psychanalystes.
L’expérience du transfert peut nous convaincre qu’une telle implication est indispensable pour garantir “l’ancrage du dire, de la parole, dans le Réel de la clinique, de la souffrance humaine qui l’habite. En écho me revient le choix de Paul Hentgen lorsqu’il écrit : “plutôt que d’aller plus loin dans l’évocation des associations et hypothèses, j’aimerais brièvement relever la formulation dans la langue originale : no puede escuchar”(Pour rappel, il s’agissait de postuler ou supposer un pulsionnel en quête d’une mise en forme plutôt que de considérer son impossibilité en terme de structure, suspectée ou prétendue.)
Tant Macedo que P. Hentgen, indiquent la dimension proprement analytique, ancrage dans le corps et la parole, dans le corps de la parole. Il me semble que cette insistance est nécessaire pour éviter toutes dérives idéalisantes, médicalisantes, idéologisantes… à l’origine de nos “illusions de psychanalystes” !
Dans les échanges lors de la conférence, aussi bien que le samedi matin, c’est à un dépassement de nos attitudes conceptuelles, des positions intellectualistes ou mentales que l’analyste est convié, invité à être “dans l’incarnation de l’affect, à continuer toujours d’être enseigné par l’hystérique en demande de symbolique”. “Voilà, nous dit Macedo, ce qui nous permet de garder le “cap sur l’ouvert”.
Mise en garde encore de considérer l’analysant comme une monade, sans prise en compte de son environnement que l’analyste est amené à re-présenter jusqu’à devenir à certains moments, “l’agent du traumatisme”.
Et tout cela nous conduit à une métaphore très parlante celle de “la navigation à l’intérieur du transfert”, avec pour toute boussole “ce qui a formé la pensée et la sensibilité de l’analyste” …
“Si la cure c’est la connaissance du deuxième type, la fin de l’analyse serait la connaissance du troisième type, une très grande force d’aller vers la découverte de sa place dans le monde”. Cette référence à Spinoza indique bien où se trouve les exigences analytiques, et dénonce “les catéchismes vides”. L’investissement passionné de toutes théories, aux dépens de ce long chemin de subjectivation dans le quotidien et l’intime de la psychanalyse, laisserait l’analyste dépourvu lors de la navigation dans le transfert !
Cette formule me parait avoir quelque chose “de la magie des mots” dont parle le tout premier Freud. Elle me semble propre à faire sentir le rapport transférentiel, équilibre subtil de participation et de capacité à rester un peu en retrait pour tenir une certaine place.
Parler de navigation, évoque tout de suite les romans de Conrad …. “La ligne d’ombre”, est le récit d’un capitaine qui a pour la première fois à charge de ramener son bateau à bon port tout en ayant “charge d’âmes”, il doit rester le capitaine au travers de toutes les avanies et rester en même temps embarqué sur le même navire (la même galère) que ses marins. Or naviguer, c’est aussi garder une certaine allure, garder la vitesse acquise par le bateau dans son mouvement, sans quoi le gouvernail ne fonctionne plus, et c’est le naufrage…
Dans mes notes, je retrouve encore la réponse que Heitor de Macedo a faite le samedi matin, à quelqu’un qui lui demandait son rapport à la dimension politique de la psychanalyse.
“En écrivant ce livre :”Lettres à une jeune psychanalyste” je voulais que soit donné un livre qui donne envie de mieux connaître la psychanalyse; d’avoir l’idée que si jamais le besoin de réfléchir à ce qui faisait impasse dans l’existence se faisait sentir, il était possible de s’adresser à la psychanalyse.”
Cette façon de répondre, simple et précise, comme le trait d’une épure…s’associe à la grande simplicité des mots de Freud parlant de la condition humaine : la douleur d’exister, l’envie de repli pour éviter le monde et se construire un abri, le risque de s’y emprisonner. Et puis, seule issue : cette capacité de rattacher sa vie à celle d’autres personnes. Peut être ce serait la leçon politique, la dimension politique de la psychanalyse : d’autres manières de se relier les uns aux autres.
Christiane Poncelet