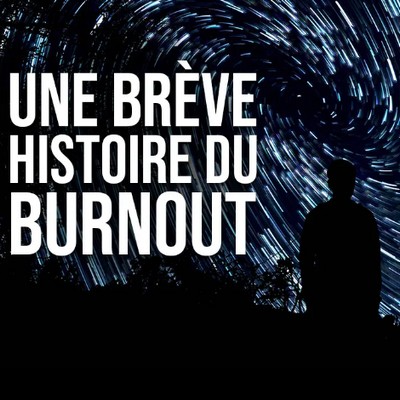 Choisir un métier dans le champ de l’aide aux personnes, c’est s’offrir à la rencontre avec les souffrances des utilisateurs de ces institutions. Finalement, on y est plutôt bien préparé par ses études même si des post-formations sont souvent nécessaires. Par contre, on est très peu formé pour travailler avec des collègues. Ce qui va s’avérer souvent beaucoup plus compliqué que prévu. Les résonances entre toutes ces souffrances peuvent produire des effets très destructeurs autant pour les utilisateurs que pour les intervenants. Pourtant, je soutiens le pari qu’en s’appliquant à construire des dispositifs formalisés de rencontres collectives et en les articulant à la qualité de moments plus informels, on peut passer de la souffrance à l’euphorie (qui d’après son étymologie grecque veut « simplement » dire « bien se porter »).
Choisir un métier dans le champ de l’aide aux personnes, c’est s’offrir à la rencontre avec les souffrances des utilisateurs de ces institutions. Finalement, on y est plutôt bien préparé par ses études même si des post-formations sont souvent nécessaires. Par contre, on est très peu formé pour travailler avec des collègues. Ce qui va s’avérer souvent beaucoup plus compliqué que prévu. Les résonances entre toutes ces souffrances peuvent produire des effets très destructeurs autant pour les utilisateurs que pour les intervenants. Pourtant, je soutiens le pari qu’en s’appliquant à construire des dispositifs formalisés de rencontres collectives et en les articulant à la qualité de moments plus informels, on peut passer de la souffrance à l’euphorie (qui d’après son étymologie grecque veut « simplement » dire « bien se porter »).
C’est d’autant plus vital, et sans doute surtout actuellement, que de nombreux professionnels témoignent d’un vécu d’intenses souffrances liées au travail. Que ce soit dans le champ de la santé mentale, de l’aide à la jeunesse, dans le secteur de la prévention ou dans celui de l’action sociale, les plaintes abondent. Sur le terrain, le même paradoxe déjà évoqué saute aux yeux : les intervenants sont généralement bien formés pour travailler avec des utilisateurs, mais très peu pour interagir et collaborer avec des collègues. J’insiste sur cette dimension tellement elle me semble négligée. Or, une très grande part des souffrances dans le travail se manifeste précisément dans les difficultés rencontrées en équipe ou dans les pratiques de réseau qui se multiplient. Pourtant, il faut à la fois traiter les souffrances liées aux résonances avec les utilisateurs et celles qui se manifestent entre collègues, sans oublier les dysfonctionnements propres aux institutions.
Ces ravages ont en partie lieu parce qu’ils sont liés au mythe contemporain de l’autorégulation. Ce mythe me semble socialement d’autant plus omniprésent qu’il est partagé par des intervenants très engagés dans leur travail et défendant des valeurs de gauche (voire même d’extrême gauche) alors qu’il rencontre parfaitement, par ailleurs, l’idéologie néolibérale.
Trop souvent, les professionnels semblent croire qu’être compétents et adultes responsables devrait leur permettre de se réunir et de collaborer sans construire des dispositifs dont l’élaboration est subtile et complexe mais sans lesquels leurs échanges risquent vite de conduire à des conflits stériles et destructeurs.
L’enjeu est de donner des outils théoriques et concrets pour comprendre les souffrances institutionnelles et pour les transformer en travail collectif créateur autant pour les intervenants que pour les utilisateurs, tout en combattant les dérives managériales de plus en plus envahissantes et toxiques. Cela passe par le tissage dans le quotidien institutionnel, par la construction de dispositifs formalisés (en partie contraignants mais finalement libérateurs) articulés à un soin pour les ambiances et l’informel.
Il s’agit donc de montrer comment on peut articuler les fonctions qui permettent une pensée nouvelle, habitée dans la mesure où elle est en lien avec les vécus émotionnels et les sensations corporelles propres au travail (le « travail vivant » dont parle Christophe Dejours). D’abord, nous devons nous atteler à la culture d’une fonction Phorique (du grec phoros, « qui porte ») : concept développé par Pierre Delion, Michel Balat et aussi René Roussillon. En voyant il y a peu, la représentation de Saint Christophe (celui qui, étymologiquement, porte le Christ) sur le triptyque de l’Agneau Mystique à Gand. En me rappelant qu’il est le Saint Patron des voyageurs, j’ai réalisé à quel point la fonction Phorique est la condition de base du voyage, de tous les voyages…
Cette fonction de portage peut se décliner en référence au « holding » de Winnicott tout comme en référence à la qualité du « dialogue tonique » évoqué par Ajuriaguerra et dont Albert Ciccone est venu nous parler si précisément en y ajoutant ses propres développements. Elle est aussi très en lien avec les travaux si importants de Daniel Marcelli sur cette spécificité humaine pour nous si vitale de l’échange des regards, dont étonnamment Albert Ciccone ne nous a que peu parlé. Tout cela rejoint l’œuvre d’Imre Hermann prolongée par Léopold Szondi et Jacques Schotte. La qualité de la fonction Phorique est, en fait, synonyme de la qualité du Contact.
Il est impressionnant de voir comment la théorisation du Contact rencontre ce qui est, a priori, une toute autre approche : celle de l’étude minutieuse du développement sensori moteur du jeune enfant dans les recherches d’André Bullinger et que Pierre Delion a si finement commentée. Ce fut un de mes principaux points d’appui dans un article relativement récent[1] que je vais essayer mettre aussi en ligne sur notre site.
Cette fonction Phorique qui assure à chacun la sécurité de base qui est une nécessité absolue pour que tous puissent partager avec les autres leur vécu du travail : fonction Sémaphorique[2], fonction d’échange des signes dont chacun s’est retrouvé porteur dans la rencontre que ce soit avec l’usager lui-même, avec d’autres usagers qui sont particulièrement en lien avec lui ou encore avec d’autres collègues[3]. Partager « réellement » son vécu du travail, c’est toujours se dévoiler subjectivement ; ce à quoi nous résistons plus ou moins tous à moins qu’une « parentalité groupale bienveillante » (Albert Ciccone) nous porte et assure alors la fonction Phorique.
Alors, par surprise, se manifestera la fonction Métaphorique, celle qui permet le décalage (elle vient du grec « déménagement » par exemple), la pensée nouvelle et, du coup, les décisions plus pertinentes qui vont s’imposer « naturellement » par voie de conséquence. La fonction métaphorique est de la même étoffe que celle du mot d’esprit que Freud caractérisait par un premier effet de « sidération et lumière », une sorte d’Eureka joyeux. À noter que la fonction Métaphorique produit autant les décalages explicites, dont je viens de donner quelques exemples, que de décalages « invisibles » : les échanges sur le vécu du travail, les échanges sémaphoriques donc, permettent des décaler les contretransferts au-delà de la conscience que l’on peut en avoir. C’est à ce moment que l’ambiance institutionnelle peut être habitée par une quatrième fonction que je me suis permis d’inventer. Il s’agit de la fonction Euphorique (rappelons-le, qui en grec veut dire « bien se porter »). C’est à dire que la fonction Métaphorique et ses effets de « mot d’esprit » produisent le plaisir et la satisfaction du « devoir accompli ». Réellement, dans cet échange collectif, quelque chose a eu lieu dont chacun peut retirer une fierté légitime. Par exemple, chacun sortira de réunion un rien « euphorique ». Et, cette fonction Euphorique va venir renforcer la fonction Phorique : dans notre travail, les cercles vertueux sont aussi possibles ! Il ne s’agit évidemment pas d’être porté par un optimisme béat mais d’associer la rigueur indispensable à une légèreté dont l’humour teinté d’autodérision et le vécu corporel du rire sont les symptômes positifs.
C’est ce propos parfois abstrait que je vous propose maintenant d’illustrer par une histoire. L’histoire en question est celle de l’invention du concept de « burn out ». Elle est pour moi riche de très nombreux enseignements. Son inventeur, Herbert Freudenberger exerçait comme psychologue et psychothérapeute à New York. Durant les années soixante, il travaillait la journée en psychiatrie puis travaillait le soir dans une free clinic qu’il avait créée. Il était en effet très sensible aux ravages des consommations massives de drogues illégales dans son quartier. Extrêmement zélé (trop même comme on le verra, ce qui est toujours un des facteurs majeurs prédisposant au burn out), il commença à s’impliquer sans limites dans ses différents engagements professionnels et se mit à travailler tous les jours de 8H du matin jusqu’à 2H dans la nuit.
Son entourage devint de plus en plus préoccupé par sa santé, son amaigrissement, son teint de plus en plus gris, etc. En famille, il était de plus en plus irritable et intolérant. Il avait pris l’habitude de banaliser tous ces signes et de répondre à toutes ces remarques par des pirouettes. Et quand on voulait lui faire comprendre qu’il en faisait trop, il répondait qu’au contraire il ne travaillerait jamais assez devant l’ampleur des désastres qu’il constatait tous les jours. En partie contraint et forcé, il accepta de partir en vacances avec sa famille. L’avion fut réservé, le séjour organisé.
Mais, le matin où il devait se lever pour prendre cet avion, il se retrouva dans l’incapacité physique de sortir de son lit ( !), les vacances durent être annulées… Son corps dont sa pensée s’était déconnectée, vint se rappeler à lui d’une manière brutale et imprévue ; ce qui est aussi typique de ce qui signe le début d’un burn out dont les autres signes annonciateurs ne sont généralement pas pris en compte par la personne elle-même. Lors des semaines qui suivirent, il passa presque tout son temps à dormir. Quelque peu retapé, il essaya de comprendre ce qui lui était arrivé en utilisant une méthode très pertinente. À noter cependant qu’il ne demanda pas d’aide extérieure, ce qui s’éclairera aussi par la suite.
Dès ce moment, Herbert Freudenberger utilisa un magnétophone. Pendant un certain temps, il s’enregistrait racontant ses expériences de travail puis réécoutait les bandes. Ce qu’il écrira par la suite dans son premier livre sur le burn out[4], va s’avérer particulièrement instructif. En effet, il racontera que, très vite, il devint de moins en moins sensible aux contenus de ses phrases. Mais, par contre, ce seront le son de sa voix, son débit, ses arrêts, sa respiration—c’est-à-dire tous les messages non verbaux d’une énonciation par définition toujours singulière—qui viendront attirer son attention. J’en conclus que, même s’il a opéré ce travail de réflexion[5] seul, il a réussi à se dédoubler pour permettre à une sorte d’effet miroir de le reconnecter avec ses émotions et avec son corps.
C’est là qu’il faut introduire quelques éléments de réflexion sur les expériences traumatiques. Parce qu’un des effets des traumas est justement de provoquer une déconnexion entre la sphère des pensées, celle des affects et celle des sensations corporelles. Or, il y a régulièrement dans notre travail des vécus traumatiques parfois évidents mais, bien souvent, beaucoup plus insidieux (micro-traumas qui peuvent être cumulatifs) et pouvant se déployer entre collègues dans des ambiances institutionnelles délétères. Il y a aussi, de par la nature de notre travail, le contact quotidien avec les vécus traumatiques des utilisateurs et de leurs familles, et plus largement ce contact quotidien avec des souffrances et de la négativité, de la destructivité. Sans compter que ce qui est inhérent au travail lui-même vient régulièrement rentrer en résonances avec nos histoires et nos fragilités personnelles.
Dans le cas de Freudenberger, son propre burn out n’est sans doute pas sans lien avec son parcours de vie. Né Allemand en 1927 à Frankfort, il a dû, comme beaucoup d’enfants juifs, émigrer en 1933 mais sans ses parents qui n’avaient sans doute pas les moyens de voyager avec lui. C’est donc seul et très jeune qu’il a profité des réseaux secrets qui lui ont permis d’éviter le pire. Il lui a fallu plusieurs années pour arriver enfin aux États-Unis où il a d’abord vécu de nombreux petits boulots. On peut donc faire l’hypothèse qu’il a connu des ruptures d’attachement suivies d’un certain nombre de vécus traumatiques et associés à la culpabilité des survivants. Ce n’est sans doute pas pour rien qu’il a finalement choisi une profession dans le champ des relations d’aide et qu’il s’y est engagé sans limites ne comptant que sur lui-même (comme beaucoup de « survivants »), jusqu’à la maltraitance de soi-même et de son entourage. Je crois aussi utile d’ajouter que dans la pratique clinique qui fut la sienne, l’on est très souvent l’objet de ce que Melanie Klein a appelé « identification projective ». Cela correspond à un mécanisme de défense archaïque qu’utilisent inconsciemment beaucoup de populations que nous rencontrons. Ces utilisateurs doivent se débarrasser d’une destructivité qui menace de les submerger et qu’ils ne peuvent contenir. Pour se faire, ils nous bombardent de « projectiles » (expression de Pierre Delion) parfois par la violence de leurs comportements, de leurs propos ou même de leur silence, parfois par une transmission moins spectaculaire de leur détresse, de leurs souffrances et de leur grande difficulté à en faire autre chose. Alors, ils nous en chargent. Mais, nous sommes alors « chargés » de cette destructivité avec la particularité que comme elle n’a pas pu être pensée, métabolisée, par les utilisateurs eux-mêmes, nous sommes atteints par des phénomènes que nous avons aussi le plus grand mal à comprendre et qui viennent comme s’implanter essentiellement dans notre corps, parfois aussi dans des vécus émotionnels dont nous ne savons que faire. C’est pour cela, notamment, que nos contextes institutionnels doivent se doter de dispositifs de réunion et favoriser une ambiance de confiance réciproque qui peut aussi permettre des échanges plus informels. À l’image de Freudenberger avec son magnétophone mais en profitant plutôt de la richesse potentielle d’échanges collectifs avec des autres en chair et en os, il faudrait pouvoir commencer « simplement » par déposer le vécu du travail qui passe souvent d’abord par des émotions intenses, des vécus corporels étranges (fonction Sémaphorique possible seulement si est présente la fonction Phorique). L’expérience montre que c’est à partir de là qu’une pensée nouvelle de la situation arrive alors dans un temps second tout en étant beaucoup plus pertinente et incarnée (fonction Métaphorique). Évidemment, cela suppose une qualité d’écoute et de tact, l’absence de risque de disqualifications et une mise au travail de l’inventivité collective ; tout cela est loin d’être gagné d’avance.
Pour comprendre encore mieux les enseignements de l’expérience de Freudenberger, il n’est pas inutile de savoir qu’il n’a pas inventé le terme de burn out. Il l’a, en effet, emprunté à l’argot de ces patients gros consommateurs de drogues qui, quand ils se sentaient au bout du rouleau, disait d’eux-mêmes qu’ils étaient « cramés », burn out. Je crois qu’il faut, ici, retenir que ce dont il s’agit est une des dimensions de la condition humaine qui transcende l’opposition beaucoup trop simpliste entre lesdits utilisateurs et lesdits professionnels.
De la même manière, s’il faut penser des dispositifs pour travailler avec des utilisateurs où l’enjeu sera tout autant de pouvoir au mieux les accueillir que de pouvoir accueillir ce que cela va susciter en nous ; il faut, ce devrait être évident, penser des dispositifs où l’on va pouvoir s’accueillir entre collègues, accueillir ce qui vient en nous et pouvoir bénéficier de la sécurité nécessaire pour le déposer, accueillir aussi ce que cela va susciter chez l’autre.
En guise de conclusion, je formulerai plusieurs points : 1/ Il est indispensable que nous soyons suffisamment au clair avec ce qui nous a conduit à exercer une profession qui rend rarement riche, est rarement confortable et pas toujours très bien reconnue socialement. Il s’agit là de notre responsabilité individuelle. D’être psychanalyste nous le savons, mais notre travail sur ce que Winnicott distinguait comme « contre-transfert subjectif » pour dégager la place du « contre-transfert objectif[6] » est par définition infini. 2/ Au niveau groupal (au sens de René Kaës), que ce soit au sein d’une équipe ou d’un réseau, il y a une responsabilité collective à se mettre d’accord sur des règles qui vont permettre d’échanger des différences de points de vue inévitables de sorte à ce que la dimension éventuelle conflictuelle de la confrontation fasse avancer le débat au lieu de laisser chacun avec des blessures qui auront parfois beaucoup de mal à cicatriser. 3/ Au niveau institutionnel, ceux qui détiennent le leadership (et cela peut prendre des formes très différentes) doivent garantir la sécurité de base dont chaque travailleur a besoin pour prendre les inévitables risques que le travail comporte. Ils doivent aussi donner les directions que le projet institutionnel doit prendre pour remplir au mieux sa mission. Il faut donc qu’ils garantissent suffisamment de temps et d’espaces dans lesquels un vrai travail de la pensée est possible. Ce qui, rappelons-le, est tout autant une expérience corporelle, émotionnelle qu’intellectuelle. Évidemment, la responsabilité plus particulière du leadership officiel ne dédouane pas tout un chacun de sa propre responsabilité. 4/ Au niveau social, la tendance actuelle amène à penser qu’il faudrait distinguer le plus clairement possible le contenu du travail de son organisation. Cette organisation devrait par ailleurs être la plus « rationnelle » possible. Cette croyance conduit à faire primer l’organisation sur le contenu même du travail, de même qu’elle conduit à penser que les mêmes schémas organisationnels devraient être pertinents dans tous les contextes institutionnels. Dès lors, on voit le secteur non-marchand envahi par des logiques managériales venant de l’entreprise. Il faut bien sûr éviter absolument de diaboliser a priori tous les « managers » sans pour autant minimiser les effets très destructeurs de certaines dérives managériales. 5/ Au niveau politique, les pouvoirs subsidiants ont tendance à suivre le même mouvement. À nous de faire l’effort de prendre en compte leurs contraintes et parler leur langage (ce qui nous demande souvent un effort de traduction !) pour défendre nos logiques de travail. Reste à savoir jusqu’où il est possible de négocier et là où commence la résistance, sachant qu’à l’image des résistants de la deuxième guerre mondiale une résistance efficace suppose une organisation collective autant solidaire que rigoureuse. On retombe alors sur les mêmes logiques qui peuvent présider à la meilleure collaboration collective possible.
Mais, où sont donc passés le rire et l’euphorie au travers de propos aussi sérieux ? C’est que le plaisir et la fierté du travail bien accompli produisent toujours plus de reconnaissance et de confiance réciproque. Et la tolérance qui permet le partage véritable fait toujours apparaître l’irréductible côté surréaliste auquel beaucoup de situations nous confrontent. C’est alors que le rire nous déborde et que rire à plusieurs produit une saine euphorie alors bien méritée ! Elle nous aide tout autant à nous désintoxiquer de certains vécus du travail qu’à nous rendre plus accueillants et plus inventifs. Tout le monde en ressort gagnant et si nous n’avons qu’un pouvoir limité sur le cours des événements, il n’y a aucune bonne raison de désespérer. Sur le travailler ensemble nous avons un pouvoir d’agir[7] que nous négligeons trop souvent.
Et gageons, que Freudenberger, sorti de son brun out, a dû après-coup beaucoup rire de la démesure « surréaliste » qui s’était emparée de lui !
Didier Robin
[1] Robin D., « Pour une théorie psychanalytique de l’attachement. Ce que l’observation des singes apprend au psychanalyste : l’archaïque et le pulsionnel », Erès, Le Coq-héron 2013/4 – n° 215, pages 50 à 68.
[2] Toujours selon les mêmes Pierre Delion, Michel Balat et René Roussillon.
[3] Ce que depuis François Tosquelles on appelle la « constellation transférentielle ».
[4] H, J, Freudenberger., La brûlure interne. Le prix élevé du succès, Québec, Inédi, 1982.
[5] Ce mot de « réflexion » n’est pas sans écho avec le concept de « réflexivité » développé par René Roussillon. Ce travail de la réflexivité débute très tôt dans notre histoire : dans les situations suffisamment bonnes, le nourrisson montre, émet des signes d’abord corporels et les adultes qui s’occupent de lui, en réponse, nomment, questionnent, émettent des hypothèses sur ses vécus. Au fur et à mesure du développement, cette interaction est intériorisée et nous permet (ou pas et toujours dans une certaine mesure, ce travail n’est jamais terminé et passe toujours par la qualité du rapport à l’autre, aux collègues par exemple !) de pouvoir nommer de manière suffisamment congruente nos affects et nos sensations corporelles même si nous avons aussi un inconscient toujours à l’œuvre.
[6] D. W. Winnicott, « La haine dans le contre-transfert », in De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, Payot, 1969.
[7] Yves Clot